|
| 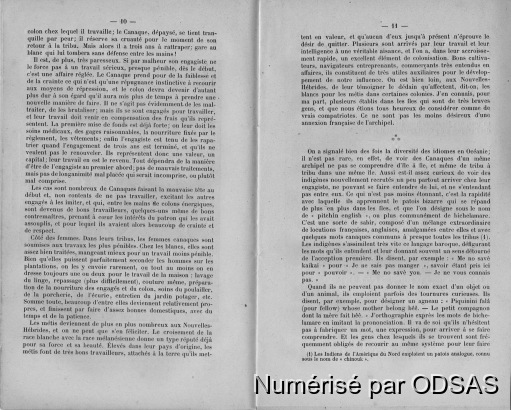
[Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
__-|0._
colon chez lequel il travaille; le Canaque, dépaysé, se tient tran-
quille par peur; il réserve sa cruauté pour le moment de son
retour à la tribu. Mais alors il a trois ans a rattraper; gare au
blanc qui lui tombera sans défense entre les mains
Il est, de plus, très paresseux. Si par malheur son engagiste ne
le force pas à un travail sérieux, presque pénible, dès le début,
c’est une affaire réglée. Le Canaque prend pour de la faiblesse et
de la crainte ce qui n’est qu’une répugnance instinctive à recourir
aux moyens de répression, et le colon devra devenir d'autant
plus dur à son égard qu’il aura mis plus le temps à prendre une
nouvelle manière de faire. Il ne s’agit pas évidemment. de les mal-
traiter, de les brutaliser; mais ils se sont engagés pour travailler‘,
et leur travail doit venir en compensation des frais qu’ils repré-
sentent. La première mise de fonds est déjà forte; on leur doit les
soins médicaux, des gages raisonnables, la nourriture fixée par le
règlement, les vêtements; enfin Fengagiste est tenu de les rapa-
trier quand Pcngagcment de trois ans est terminé, et prils ne
veulent pas le renouveler. Ils représentent donc une VALEUR, un
capital; leur travail en est le revenu. Tout dépendra de la manière
d’ètre de Vengagistc au premier abord; pas de mauvais traitements,
mais pas de longanimité mal placée qui serait incomprise, ou plutôt
mal comprise.
Les cas sont nombreux de Canaques faisant la mauvaise tète au
début et, non contents de ne pas travailler, excitant les autres
engagés à les imiter, et qui, entre les mains de colons énergiques,
sont devenus de bons travailleurs, quelques-uns mème de bons
contrcinaîtres, prenant à cœur les intérèts du patron qui les avait
assouplis, et pour lequel ils avaient alors beaucoup de crainte et
de respect. '
Côté des femmes. Dans leurs tribus, les femmes canaques sont
soumises aux travaux les plus pénibles. Chez les blancs, elles sont
assez bien traitées, mangeant mieux pour un travail moins pénible.
Bien qu’elles puissent parfaitement seconder les hommes sur les
plantations, on les y envoie rarement, ou tout au moins on en
dresse toujours une ou deux pour le travail de la maison : lavage
du linge, repassage plus difficilement", couture mèmc, prépara-
tion de la nourriture des engagés et du colon, soins du poulailler.
de la porcherie, de Fécurie, entretien du jardin potager, etc.
Somme toute, beaucoup «l'entre elles deviennent relativement pro-
pres, et finissent par faire d'assez bonnes domestiques, avec du
temps et de la patience.
Les métis deviennent de plus en plus nombreux aux Nouvelles-
Ilébrides, et on ne peut que s'en féliciter. Le croisement de la
race blanche avec la race iiiélxiiiésienni: donne un type réputé léjà
pour sa force et sa beauté. lilevés lîlllS leur pays «l'origine, les
métis font de très bons travailleurs, attachés a la terre prils inet-
'—ii—
tent en VALEUR, et qu’aucun d’eux jusqu'à présent n’éprouve'le
désir de quitter. Plusieurs sont arrivés par leur travail etleur
intelligence à une véritable aisance, et l'on a, dans leur accroisse-
ment rapide, un excellent élément de colonisation. Bons cultiva-
teurs, navigateurs entreprenants, commerçants très entendus en
affaires, ils constituent de très utiles auxiliaires pour ledévelop-
pement de notre influence. On est bien loin, aux 1_ouvelles—
llébrides, de leur témoigner le dédain qualïeçlcnta ‘MÏOD: les
blancs pour les métis dans certaines colonies. J en connais, pour
ma part, plusieurs établis dans les îles qui sont de très braves
gens, et que nous étions tous heureux de considérer comme de
vrais compatriotes. Ce ne sont pas les moins désireux dune
annexion française de farcliipel.
n-
On a signalé bien des fois la diversité des idiomes en Océanie;
il n’est pas rare, en effet, de voir des Canaques d'un nième
archipel ne pas se comprendre d'île à île, et même de tribu a
tribu dans une même île. Aussi est—il assez curieux de voir des
indigènes nouvellement recrutés un peu partout arriver cliez leur
engagiste, ne pouvant se faire entendre de lui, et ne sentendant
pas entre eux. Ce qui n’est pas moins étonnant, c’est la rapidité
avec laquelle ils apprennent le patois bizarre qui se répand
de plus en plus dans les îles, et que l’on désigne sous le nom
de a pitcliin eiiglisli r. ou plus communément de bichelaiiiare.
C'est une sorte de sabir, composé d"un mélange extraordinaire
de locutions françaises, anglaises, ainalgamées entre elles et avec
quelques mots canaques communs à presque toutes les tribus l.
Les indigènes s’assimilent très vite ce langage baroque. défigurant
les mots qu’ils entendent et leur donnant souvent un sens détourné
de l'acception première. Ils disent, par exemple: c Me no savè
kaikai a» pour c Je ne sais pas manger n, savoir étant pris ici
pour . pouvoir >. — a Me no savè you. — Je ne vous connais
pas. z _ _
Quand ils ne peuvent pas donner le nom exact d un objet ou
d’un animal, ils emploient parfois des tournures curieuses. Ils
disent, par exemple. pour désigner un agneau : u I’icjiiinini falà
pour fellow wliose inotlier belong bèè. — Le petit compagnon
dont la mère fait bèé. n Jbrtliograpliie exprès les mots de biche-
lamare en imitant la prononciation. Il va de soi qu'ils llylléslltîlll
pas à fabriquer un mot, une expression, pour arriver a se faire
comprendre. Et les gens chez lesquels ils se trouvent sont fre-
queiiiinent obligés de recourir au même système pour leur faire
l Les Indiens de_ fàniérique du Nord emploient un patois analogue, connu
sous le nom de a cliinouk n.
|