|
| 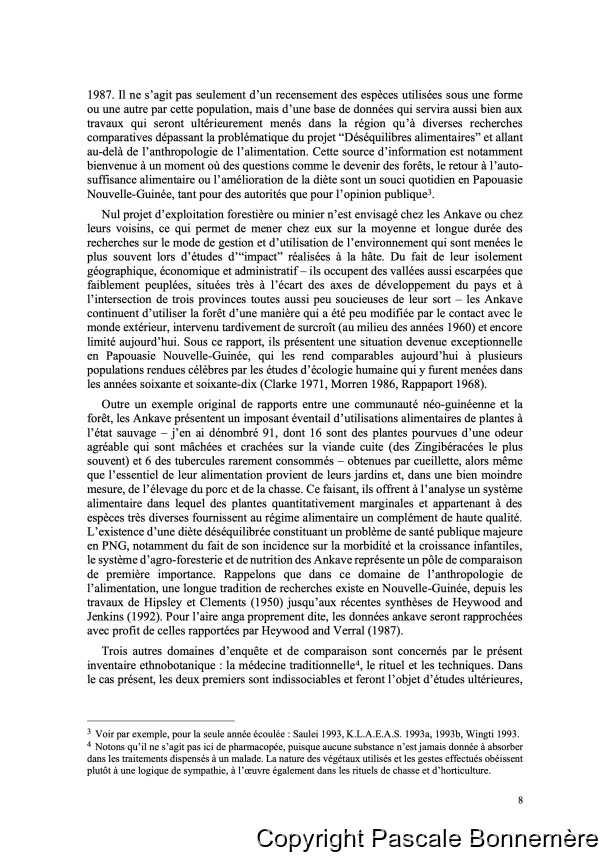 [Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
1987. Il ne s’agit pas seulement d’un recensement des espèces utilisées sous une forme
ou une autre par cette population, mais d’une base de données qui servira aussi bien aux
travaux qui seront ultérieurement menés dans la région qu’à diverses recherches
comparatives dépassant la problématique du projet “Déséquilibres alimentaires” et allant
au-delà de l’anthropologie de l’alimentation. Cette source d’information est notamment
bienvenue à un moment où des questions comme le devenir des forêts, le retour à l’auto-
suffisance alimentaire ou l’amélioration de la diète sont un souci quotidien en Papouasie
Nouvelle-Guinée, tant pour des autorités que pour l’opinion publiques.
Nul projet d’exploitation forestière ou minier n’est envisagé chez les Ankave ou chez
leurs voisins, ce qui permet de mener chez eux sur la moyenne et longue durée des
recherches sur le mode de gestion et d’utilisation de l’environnement qui sont menées le
plus souvent lors d’études d’“impact” réalisées à la hâte. Du fait de leur isolement
géographique, économique et administratif — 1ls occupent des vallées aussi escarpées que
faiblement peuplées, situées très à l’écart des axes de développement du pays et à
l’intersection de trois provinces toutes aussi peu soucieuses de leur sort — les Ankave
continuent d’utiliser la forêt d’une manière qui a été peu modifiée par le contact avec le
monde extérieur, intervenu tardivement de surcroît (au milieu des années 1960) et encore
limité aujourd’hui. Sous ce rapport, ils présentent une situation devenue exceptionnelle
en Papouasie Nouvelle-Guinée, qui les rend comparables aujourd’hui à plusieurs
populations rendues célèbres par les études d’écologie humaine qui y furent menées dans
les années soixante et soixante-dix (Clarke 1971, Morren 1986, Rappaport 1968).
Outre un exemple original de rapports entre une communauté néo-guinéenne et la
forêt, les Ankave présentent un imposant éventail d’utilisations alimentaires de plantes à
l’état sauvage — j’en ai dénombré 91, dont 16 sont des plantes pourvues d’une odeur
agréable qui sont mâchées et crachées sur la viande cuite (des Zingibéracées le plus
souvent) et 6 des tubercules rarement consommés — obtenues par cueillette, alors même
que l’essentiel de leur alimentation provient de leurs jardins et, dans une bien moindre
mesure, de l’élevage du porc et de la chasse. Ce faisant, ils offrent à l’analyse un système
alimentaire dans lequel des plantes quantitativement marginales et appartenant à des
espèces très diverses fournissent au régime alimentaire un complément de haute qualité.
L’existence d’une diète déséquilibrée constituant un problème de santé publique majeure
en PNG, notamment du fait de son incidence sur la morbidité et la croissance infantiles,
le système d’agro-foresterie et de nutrition des Ankave représente un pôle de comparaison
de première importance. Rappelons que dans ce domaine de l’anthropologie de
l’alimentation, une longue tradition de recherches existe en Nouvelle-Guinée, depuis les
travaux de Hipsley et Clements (1950) jusqu’aux récentes synthèses de Heywood and
Jenkins (1992). Pour l’aire anga proprement dite, les données ankave seront rapprochées
avec profit de celles rapportées par Heywood and Verral (1987).
Trois autres domaines d’enquête et de comparaison sont concernés par le présent
inventaire ethnobotanique : la médecine traditionnelle{, le rituel et les techniques. Dans
le cas présent, les deux premiers sont indissociables et feront l’objet d’études ultérieures,
3 Voir par exemple, pour la seule année écoulée : Saulei 1993, K.L.A.E.A.S. 1993a, 1993b, Wingti 1993.
4 Notons qu’il ne s’agit pas ici de pharmacopée, puisque aucune substance n’est jamais donnée à absorber
dans les traitements dispensés à un malade. La nature des végétaux utilisés et les gestes effectués obéissent
plutôt à une logique de sympathie, à l’œuvre également dans les rituels de chasse et d’horticulture.
�
|