|
| 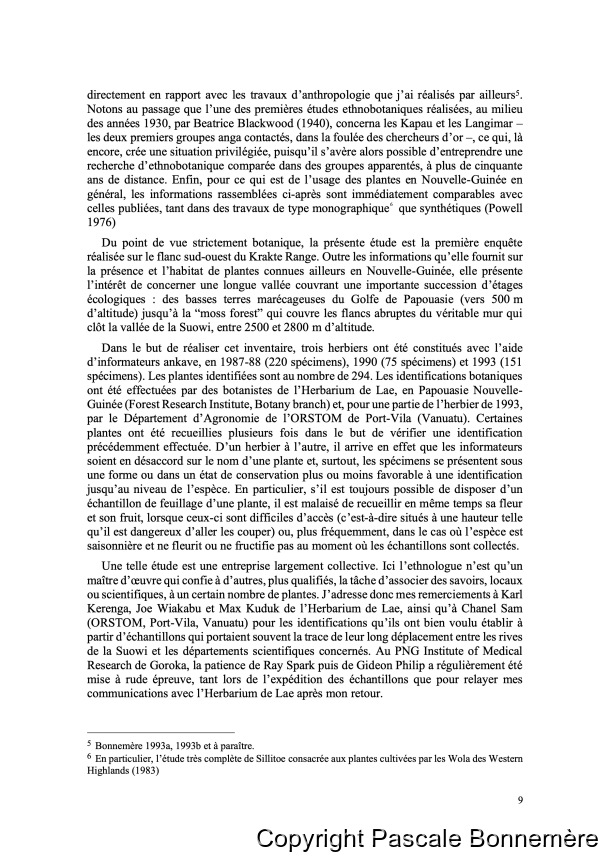 [Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
directement en rapport avec les travaux d’anthropologie que j’ai réalisés par ailleurss.
Notons au passage que l’une des premières études ethnobotaniques réalisées, au milieu
des années 1930, par Beatrice Blackwood (1940), concerna les Kapau et les Langimar —
les deux premiers groupes anga contactés, dans la foulée des chercheurs d’or -—, ce qui, là
encore, crée une situation privilégiée, puisqu'il s’avère alors possible d’entreprendre une
recherche d’ethnobotanique comparée dans des groupes apparentés, à plus de cinquante
ans de distance. Enfin, pour ce qui est de l’usage des plantes en Nouvelle-Guinée en
général, les informations rassemblées ci-après sont immédiatement comparables avec
celles publiées, tant dans des travaux de type monographique* que synthétiques (Powell
1976)
Du point de vue strictement botanique, la présente étude est la première enquête
réalisée sur le flanc sud-ouest du Krakte Range. Outre les informations qu’elle fournit sur
la présence et l’habitat de plantes connues ailleurs en Nouvelle-Guinée, elle présente
l’intérêt de concerner une longue vallée couvrant une importante succession d’étages
écologiques : des basses terres marécageuses du Golfe de Papouasie (vers 500 m
d'altitude) jusqu’à la “moss forest” qui couvre les flancs abruptes du véritable mur qui
clôt la vallée de la Suowi, entre 2500 et 2800 m d’altitude.
Dans le but de réaliser cet inventaire, trois herbiers ont été constitués avec l’aide
d’informateurs ankave, en 1987-88 (220 spécimens), 1990 (75 spécimens) et 1993 (151
spécimens). Les plantes identifiées sont au nombre de 294. Les identifications botaniques
ont été effectuées par des botanistes de l’Herbarium de Lae, en Papouasie Nouvelle-
Guinée (Forest Research Institute, Botany branch) et, pour une partie de l’herbier de 1993,
par le Département d’Agronomie de l’'ORSTOM de Port-Vila (Vanuatu). Certaines
plantes ont été recueillies plusieurs fois dans le but de vérifier une identification
précédemment effectuée. D’un herbier à l’autre, il arrive en effet que les informateurs
soient en désaccord sur le nom d’une plante et, surtout, les spécimens se présentent sous
une forme ou dans un état de conservation plus ou moins favorable à une identification
jusqu’au niveau de l’espèce. En particulier, s’il est toujours possible de disposer d’un
échantillon de feuillage d’une plante, il est malaisé de recueillir en même temps sa fleur
et son fruit, lorsque ceux-ci sont difficiles d’accès (c’est-à-dire situés à une hauteur telle
qu’il est dangereux d’aller les couper) ou, plus fréquemment, dans le cas où l’espèce est
saisonnière et ne fleurit ou ne fructifie pas au moment où les échantillons sont collectés.
Une telle étude est une entreprise largement collective. Ici l’ethnologue n’est qu’un
maître d’œuvre qui confie à d’autres, plus qualifiés, la tâche d’associer des savoirs, locaux
ou scientifiques, à un certain nombre de plantes. J’adresse donc mes remerciements à Karl
Kerenga, Joe Wiakabu et Max Kuduk de l’Herbarium de Lae, ainsi qu’à Chanel Sam
(ORSTOM, Port-Vila, Vanuatu) pour les identifications qu’ils ont bien voulu établir à
partir d’échantillons qui portaient souvent la trace de leur long déplacement entre les rives
de la Suowi et les départements scientifiques concernés. Au PNG Institute of Medical
Research de Goroka, la patience de Ray Spark puis de Gideon Philip a régulièrement été
mise à rude épreuve, tant lors de l’expédition des échantillons que pour relayer mes
communications avec l’Herbarium de Lae après mon retour.
5 Bonnemère 1993a, 1993b et à paraître.
6 En particulier, l’étude très complète de Sillitoe consacrée aux plantes cultivées par les Wola des Western
Highlands (1983)
�
|