|
| 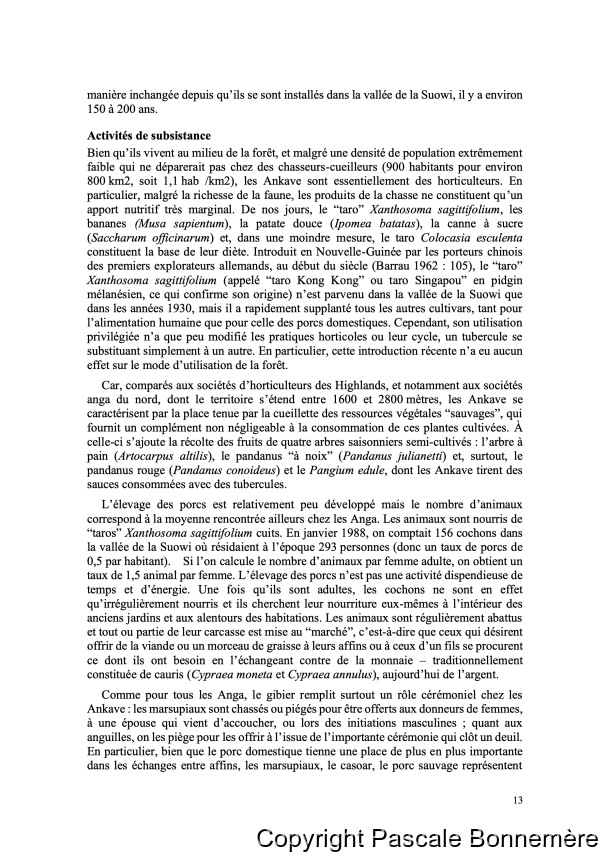 [Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
manière inchangée depuis qu’ils se sont installés dans la vallée de la Suowi, il y a environ
150 à 200 ans.
Activités de subsistance
Bien qu’ils vivent au milieu de la forêt, et malgré une densité de population extrêmement
faible qui ne déparerait pas chez des chasseurs-cueilleurs (900 habitants pour environ
800 km?2, soit 1,1 hab /km2), les Ankave sont essentiellement des horticulteurs. En
particulier, malgré la richesse de la faune, les produits de la chasse ne constituent qu’un
apport nutritif très marginal. De nos jours, le “taro” Xanthosoma sagittifolium, les
bananes (Musa sapientum), la patate douce (/pomea batatas), la canne à sucre
(Saccharum officinarum) et, dans une moindre mesure, le taro Colocasia esculenta
constituent la base de leur diète. Introduit en Nouvelle-Guinée par les porteurs chinois
des premiers explorateurs allemands, au début du siècle (Barrau 1962 : 105), le “taro”
Xanthosoma sagittifolium (appelé “taro Kong Kong” ou taro Singapou” en pidgin
mélanésien, ce qui confirme son origine) n’est parvenu dans la vallée de la Suowi que
dans les années 1930, mais il a rapidement supplanté tous les autres cultivars, tant pour
l’alimentation humaine que pour celle des porcs domestiques. Cependant, son utilisation
privilégiée n’a que peu modifié les pratiques horticoles ou leur cycle, un tubercule se
substituant simplement à un autre. En particulier, cette introduction récente n’a eu aucun
effet sur le mode d’utilisation de la forêt.
Car, comparés aux sociétés d’horticulteurs des Highlands, et notamment aux sociétés
anga du nord, dont le territoire s’étend entre 1600 et 2800 mètres, les Ankave se
caractérisent par la place tenue par la cueillette des ressources végétales “sauvages”, qui
fournit un complément non négligeable à la consommation de ces plantes cultivées. À
celle-ci s’ajoute la récolte des fruits de quatre arbres saisonniers semi-cultivés : l’arbre à
pain (Artocarpus altilis), le pandanus “à noix” (Pandanus julianetti) et, surtout, le
pandanus rouge (Pandanus conoïideus) et le Pangium edule, dont les Ankave tirent des
sauces consommées avec des tubercules.
L'élevage des porcs est relativement peu développé mais le nombre d’animaux
correspond à la moyenne rencontrée ailleurs chez les Anga. Les animaux sont nourris de
“taros” Xanthosoma sagittifolium cuits. En janvier 1988, on comptait 156 cochons dans
la vallée de la Suowi où résidaient à l’époque 293 personnes (donc un taux de porcs de
0,5 par habitant). Si l’on calcule le nombre d’animaux par femme adulte, on obtient un
taux de 1,5 animal par femme. L’élevage des porcs n’est pas une activité dispendieuse de
temps et d’énergie. Une fois qu’ils sont adultes, les cochons ne sont en effet
qu’irrégulièrement nourris et ils cherchent leur nourriture eux-mêmes à l’intérieur des
anciens jardins et aux alentours des habitations. Les animaux sont régulièrement abattus
et tout ou partie de leur carcasse est mise au “marché”, c’est-à-dire que ceux qui désirent
offrir de la viande ou un morceau de graisse à leurs affins ou à ceux d’un fils se procurent
ce dont ils ont besoin en l’échangeant contre de la monnaie — traditionnellement
constituée de cauris (Cypraea moneta et Cypraea annulus), aujourd’hui de l’argent.
Comme pour tous les Anga, le gibier remplit surtout un rôle cérémoniel chez les
Ankave : les marsupiaux sont chassés ou piégés pour être offerts aux donneurs de femmes,
à une épouse qui vient d’accoucher, ou lors des initiations masculines ; quant aux
anguilles, on les piège pour les offrir à l’issue de l’importante cérémonie qui clôt un deuil.
En particulier, bien que le porc domestique tienne une place de plus en plus importante
dans les échanges entre affins, les marsupiaux, le casoar, le porc sauvage représentent
13
�
|