|
| 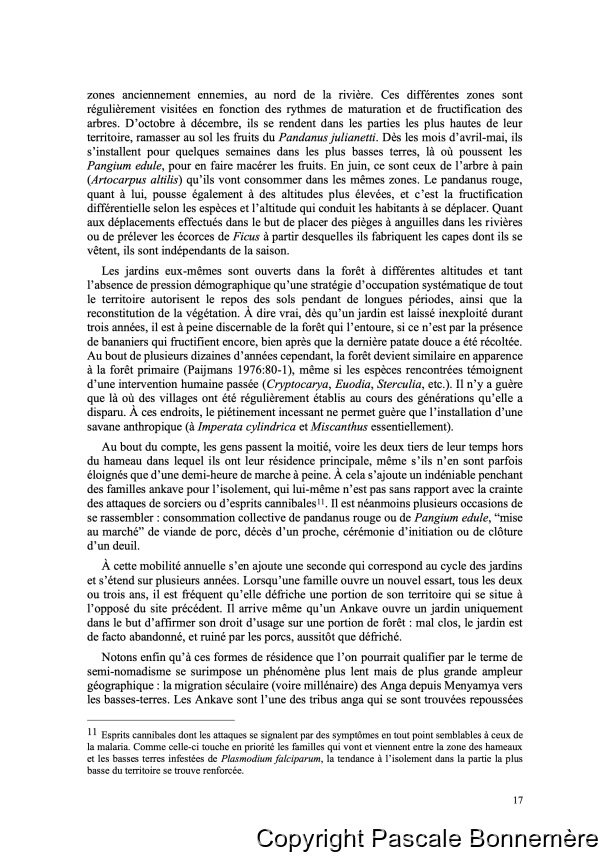 [Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
zones anciennement ennemies, au nord de la rivière. Ces différentes zones sont
régulièrement visitées en fonction des rythmes de maturation et de fructification des
arbres. D’octobre à décembre, ils se rendent dans les parties les plus hautes de leur
territoire, ramasser au sol les fruits du Pandanus julianetti. Dès les mois d’avril-mai, ils
s’installent pour quelques semaines dans les plus basses terres, là où poussent les
Pangium edule, pour en faire macérer les fruits. En juin, ce sont ceux de l’arbre à pain
(Artocarpus altilis) qu’ils vont consommer dans les mêmes zones. Le pandanus rouge,
quant à lui, pousse également à des altitudes plus élevées, et c’est la fructification
différentielle selon les espèces et l’altitude qui conduit les habitants à se déplacer. Quant
aux déplacements effectués dans le but de placer des pièges à anguilles dans les rivières
ou de prélever les écorces de Ficus à partir desquelles ils fabriquent les capes dont ils se
vêtent, ils sont indépendants de la saison.
Les jardins eux-mêmes sont ouverts dans la forêt à différentes altitudes et tant
l’absence de pression démographique qu’une stratégie d'occupation systématique de tout
le territoire autorisent le repos des sols pendant de longues périodes, ainsi que la
reconstitution de la végétation. À dire vrai, dès qu’un jardin est laissé inexploité durant
trois années, il est à peine discernable de la forêt qui l’entoure, si ce n’est par la présence
de bananiers qui fructifient encore, bien après que la dernière patate douce a été récoltée.
Au bout de plusieurs dizaines d’années cependant, la forêt devient similaire en apparence
à la forêt primaire (Paigmans 1976:80-1), même s1 les espèces rencontrées témoignent
d’une intervention humaine passée (Cryptocarya, Euodia, Sterculia, etc.). I n’y a guère
que là où des villages ont été régulièrement établis au cours des générations qu’elle a
disparu. À ces endroits, le piétinement incessant ne permet guère que l'installation d’une
savane anthropique (à /mperata cylindrica et Miscanthus essentiellement).
Au bout du compte, les gens passent la moitié, voire les deux tiers de leur temps hors
du hameau dans lequel ils ont leur résidence principale, même s’ils n’en sont parfois
éloignés que d’une demi-heure de marche à peine. À cela s’ajoute un indéniable penchant
des familles ankave pour l’isolement, qui lui-même n’est pas sans rapport avec la crainte
des attaques de sorciers ou d’esprits cannibales!!. Il est néanmoins plusieurs occasions de
se rassembler : consommation collective de pandanus rouge ou de Pangium edule, “mise
au marché” de viande de porc, décès d’un proche, cérémonie d’initiation ou de clôture
d’un deuil.
À cette mobilité annuelle s’en ajoute une seconde qui correspond au cycle des jardins
et s’étend sur plusieurs années. Lorsqu’une famille ouvre un nouvel essart, tous les deux
ou trois ans, il est fréquent qu’elle défriche une portion de son territoire qui se situe à
l’opposé du site précédent. Il arrive même qu’un Ankave ouvre un jardin uniquement
dans le but d’affirmer son droit d’usage sur une portion de forêt : mal clos, le jardin est
de facto abandonné, et ruiné par les porcs, aussitôt que défriché.
Notons enfin qu’à ces formes de résidence que l’on pourrait qualifier par le terme de
semi-nomadisme se surimpose un phénomène plus lent mais de plus grande ampleur
géographique : la migration séculaire (voire millénaire) des Anga depuis Menyamya vers
les basses-terres. Les Ankave sont l’une des tribus anga qui se sont trouvées repoussées
11 Esprits cannibales dont les attaques se signalent par des symptômes en tout point semblables à ceux de
la malaria. Comme celle-ci touche en priorité les familles qui vont et viennent entre la zone des hameaux
et les basses terres infestées de Plasmodium falciparum, la tendance à l’isolement dans la partie la plus
basse du territoire se trouve renforcée.
17
�
|